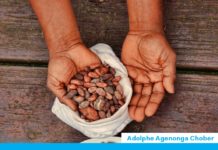Au cours de cette décennie, la jeunesse africaine est devenue un acteur collectif majeur des transformations sociopolitiques survenues sur le continent, souvent par ses engagements pacifiques en faveur de sociétés plus inclusives et plus démocratiques, au-delà du formalisme institutionnel.
À l’instar des mouvements dits du Printemps arabe (2010-2011) dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), l’Afrique subsaharienne a également été le théâtre d’une recrudescence de divers mouvements de contestation (du Sénégal au Burkina Faso, en passant par la République démocratique du Congo-RDC), menés par une frange de la jeunesse urbaine.
Ces jeunes, ouverts sur le monde et utilisant notamment les réseaux sociaux pour s’exprimer et nouer des alliances, réclament non seulement un accès aux opportunités et à de meilleures conditions socio-économiques, mais ils incarnent aussi et surtout de nouvelles façons de faire et de vivre la politique.
Bien qu’ils représentent la majorité démographique du continent, les jeunes demeurent la catégorie la plus impactée par le chômage et restent insuffisamment intégrés dans les processus politiques et de développement économique. Les difficultés d’accès à l’éducation et à l’emploi, le sentiment de marginalisation ainsi que la désaffection à l’égard des institutions et des gouvernants poussent certains à émigrer, voire à se radicaliser.
Cependant, la grande majorité de la jeunesse du continent s’est plutôt engagée dans un processus d’institutionnalisation des revendications, qui a pris la forme de mouvements citoyens structurés, tels que « Y’en a marre » (YAM) au Sénégal, « Le Balai Citoyen » au Burkina Faso, ou encore « Filimbi » et « Lucha » en RDC.
Leurs mobilisations non violentes ont significativement marqué les évolutions institutionnelles dans ces pays, en mettant notamment en échec les tentatives de prolongation inconstitutionnelle des mandats présidentiels ou la mise en œuvre de politiques impopulaires ; les mouvements citoyens ont contribué à élargir les espaces d’expression civiques, en dépit de l’adversité.
Cet ouvrage numérique complète une étude précédente du GRIP consacrée, en 2017, à la première phase d’émergence de ces mouvements et à leur rôle dans l’accompagnement des transitions politiques amorcées au cours de la décennie. Si la première phase d’émergence des mouvements citoyens a pris une forme principalement protestataire, la seconde phase abordée ici repose sur l’hypothèse d’un cheminement des mouvements citoyens vers une posture de propositions pour une transformation globale de la gouvernance et de la société.
Ce second volet de recherche se penche sur l’évolution des mouvements citoyens en Afrique subsaharienne et leur adaptation à un contexte en mutation, marqué par la poussée de nouveaux autoritarismes. Il interroge la capacité de ces mouvements à « repolitiser » les jeunes et à les mobiliser autour des objectifs de changement sociétal et d’innovation dans les pratiques civiques et politiques.
Plus fondamentalement, il s’agissait d’analyser dans quelle mesure les pratiques innovantes de ces nouveaux mouvements citoyens peuvent contribuer à « réinventer le lien politique », à réduire le fossé générationnel ainsi que la marginalisation de la jeunesse africaine dans le domaine politique, pour assurer leur participation sociopolitique effective.
Cet ouvrage s’appuie sur une série d’entretiens menés entre mai 2021 et janvier 2022, avec des activistes, membres de collectifs citoyens originaires de six pays francophones (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, RDC, Guinée Conakry, Sénégal, Togo), mais aussi d’analystes africains, observateurs privilégiés des dynamiques sociopolitiques qui traversent continent.
- Michel Luntumbue a présenté le livre le lundi 17 juillet 2023 lors du webinaire sur la relation entre les mouvements civiques et sociaux, les régimes hybrides et autoritaires, la cohésion sociale et les contrats sociaux organisé par Knowledge Platform Security & Rule of Law
- Vous retrouvez la version française du livre « Jeunesse urbaine, fracture générationnelle et réinvention du lien politique en Afrique subsaharienne » en PDF ainsi que la version anglaise du livre « Urban youth, generational divide and reinventing the political connection in sub-Saharan Africa » en PDF
« Jeunesse urbaine, fracture générationnelle et réinvention du lien politique en Afrique subsaharienne », « Urban youth, generational divide and reinventing the political connection in sub-Saharan Africa » est un projet de recherche financé par le Knowledge Management Fund (KMF), le fonds pour la recherche du ministère néerlandais des Affaires étrangères, administré par la Knowledge Platform Security & Rule of Law (KPSRL, Réseau d’experts sur la sécurité internationale et l’État de droit).
Le projet a bénéficié d’un soutien et d’un financement complémentaire de la Direction des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique (DAPG) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
L’ouvrage a fait l’objet d’un premier Webinaire de présentation en avril 2022, à l’attention d’un public francophone, en collaboration avec le Think Tank citoyen Wathi, avec la participation des plateformes citoyennes impliquées dans l’étude.