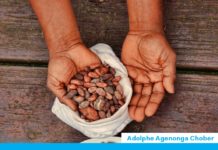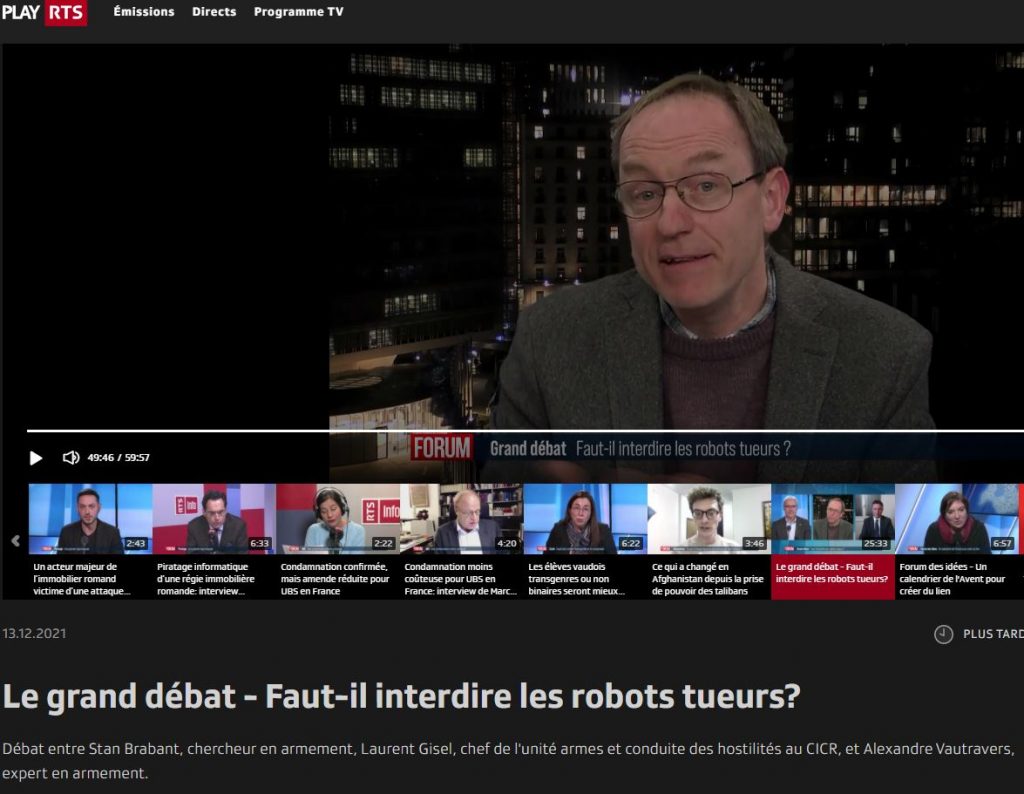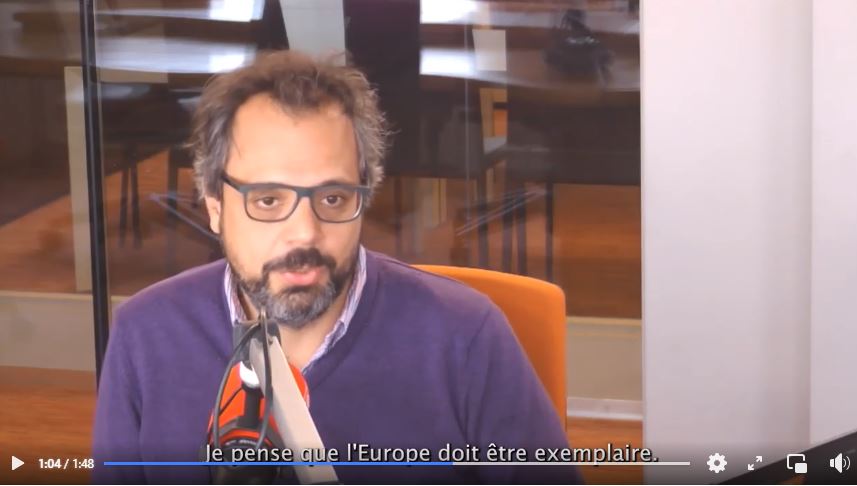Catégories
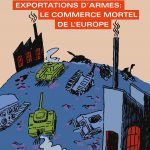
Retrouvez ici la vidéo de la présentation de la BD
Votre santé nous tient à cœur
Nous, le GRIP et la Fondation Rosa-Luxemburg, étions impatients de vous accueillir et de vous rencontrer lors d’un événement en présence à Bruxelles, avec les mesures d’hygiène correspondantes. Cependant, étant donné la situation actuelle de la pandémie en Belgique et à Bruxelles et sans aucune amélioration en vue pour les prochains jours, nous avons pris la décision de changer le lancement en un événement en ligne afin de protéger la santé de nous tous et d’apporter une petite contribution à l’endiguement de la pandémie. Nous le regrettons, mais un webinaire semble être l’option la plus sûre et la plus fiable à l’heure actuelle.
Rejoignez-nous ici, le 1er décembre à 18h00 : https://zoom.us/j/96759784243
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en ligne pour discuter du commerce européen des armes et des moyens de s’y opposer !
Recevez votre BD gratuitement chez vous
Pour rappel, la BD sera gratuitement accessible en ligne et vous pouvez d’ores et déjà en commander via ce lien depuis le site de La Rosa (en précisant la langue souhaitée dans le message en bas du formulaire d’inscription).
La BD est également désormais disponible en version numérique – Téléchargez ici la version en français, en anglais et en allemand.
Les auteurs et un panel de chercheurs spécialistes des questions d’armement présenteront la BD et animeront ensuite un débat sur le commerce des armes et les exportations d’armes européennes.
Attention, la présentation se tiendra uniquement en anglais ! (même s’il sera bien entendu possible de poser des questions dans la langue de son choix).
Infos pratiques
- Où ?
En ligne https://zoom.us/j/96759784243 - Quand ?
Le mercredi 1er décembre 2021 de 18h à 21h - Comment s’inscrire ?
https://zoom.us/j/96759784243
Un événement organisé par le GRIP et la Fondation Rosa-Luxemburg (Bureau de Bruxelles)

Le Fonds européen de la défense : Graal ou miroir aux alouettes ? (par Mathieu Saïfi)
Avec l’adoption récente du Fonds européen de la défense (FEDEF), l’UE cherche à « consolider la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense (BITD) européenne dans l’ensemble de l’Union », avec, en ligne de mire, l’ambition de devenir stratégiquement autonome. Au-delà des discours et de l’objectif annoncé par l’UE, existe-t-il un terreau fertile à la coopération en matière de recherche et de développement capacitaire en Europe ? Les États membres et leurs industries de défense partagent-ils une vision et des intérêts communs qui permettent de parler de base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) ? À travers une analyse du contexte dans lequel vient s’insérer le FEDEF, il est possible de mettre en lumière que le paysage des industries de défense en Europe est principalement dominé par des logiques et des intérêts purement nationaux. En fin de compte, si le concept de BITDE est mobilisé dans les discours politiques aujourd’hui, il n’en constitue pas pour autant une réalité industrielle, mais plutôt une construction politique.
Évolution de la législation sur les armes au Brésil : les risques de l’armement des civils (par Servane Regnard)
Le Brésil se trouve à contre-courant de la tendance mondiale qui va vers une baisse du nombre d’homicides volontaires. Le taux de criminalité place le pays dans une situation de violence quasi endémique où la sûreté des citoyen(ne)s n’est pas garantie par l’État. Dans ce contexte, un clivage est observable au sein de la société entre les proarmes et les prodésarmements, la thématique est totalement intégrée à la rhétorique politique. En 2018, le président Bolsonaro a remporté les élections sur la promesse de l’armement des civil(e)s, une stratégie présentée comme la réponse adéquate à la crise sécuritaire. Cependant, dans un pays où la violence par armes à feu est un enjeu structurel intégré aux débats politiques, quels sont les risques pour la sécurité publique posés par la position de Bolsonaro dans le débat politique ?
Les armes et munitions immergées en mer Baltique : un défi de taille pour l’Union européenne (par Celena Allio)
Au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 50 000 tonnes d’armes chimiques ont été immergées dans la mer Baltique, engendrant des conséquences parfois dramatiques pour l’homme et la biodiversité marine. L’Union européenne (UE) a commencé à se saisir du problème il y a dix ans, en mettant en place des projets de surveillance des sites de déversement. À long terme, la surveillance régulière des sites est la première option qui s’offrirait à l’UE. La seconde serait le retrait des armes. Ce Midi stratégique se propose d’étudier les deux solutions en fonction de la dangerosité des armes et des lieux d’immersion.
Nous terminerons la présentation par une séance de questions/réponses.
Inscription au Midi stratégique Armements, jeudi 9 décembre à 12h
Crédit photo inconnu : décharge sous-marine de munitions en mer Baltique / via La Relève et La Peste

 Écoutez le reportage ici (de 6:26 à 8:00) :
Écoutez le reportage ici (de 6:26 à 8:00) :
Les 6 et 7 décembre 2021, Federico Santopinto a pu assister au Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique. A cette occasion, Federico a participé à un side-event en faisant une présentation au sujet de la nouvelle Facilité européenne pour la paix, en compagnie du Général Babacar Gaye et d’autres amis et partenaires de l’Observatoire Boutros-Ghali.
- La Facilité Européenne pour la Paix (FEP) : nouveaux mécanismes, (ré)appropriations et discussions Le programme de l’évènement peut être consulté ici
- Le synopsis de l’évènement peut être consulté
Pour mieux comprendre les enjeux qui entourent le lancement de la nouvelle Facilité européenne, vous pouvez consulter les travaux récents de Federico Santopinto:

- Quelle est la contribution de la production d’armes en Wallonie par rapport aux conflits en cours ?
- Comment les décisions de produire et vendre des armes se prennent-elles ?
- Quelles sont les firmes concernées et la justification de leur lobbying ?
- Y-a-t-il à ce sujet de véritables discussions et un réel contrôle au parlement ?
- Et in fine, le citoyen peut-il peser dans les décisions ?
Erratum : contrairement à ce qui est indiqué sur l’affiche de l’événement produite par Attac-Liège, Stan Brabant n’est pas chef de projet Armes chez Amnesty.

"Faut-il interdire les robots tueurs?"(RTS)

Federico Santopinto a été interviewé par AraBel au sujet de la défense européenne et du contexte géopolitique européen, jeudi 16 décembre.

L’intervention française au Rwanda 1990-1994 : dimensions épistémologiques par Emmanuelle Carton
Le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), composé de réfugiés Tutsi en exil, envahit le Rwanda par la partie nord du pays. Trois jours plus tard, une intervention militaire française est lancée pour soutenir le gouvernement permanent du président Habyarimana contre le FPR, considéré comme une « menace » et un mouvement venu de l' »extérieur ». François Mitterrand et Juvénal Habyarimana, entourés d’une petite élite, soutienne un front contre l’avancée du FPR. Pendant que le contingent français reste au Rwanda pendant quatre ans, forme les troupes rwandaises, importe des armes ; la haine contre les Tutsis se répand lentement dans le pays par le biais de la radio, des journaux et des discours politiques. Lorsque l’avion de Juvénal Habyarimana est abattu le 7 avril 1994, le pays sombré dans la violence : les Tutsi et les Hutu modérés sont massacrés par les milices, le gouvernement génocidaire, ainsi que par une partie de la population. La France est restée au Rwanda, soutenant les troupes gouvernementales contre le FPR et essayant de protéger la population civile pendant la période du génocide également.
27 ans après le génocide rwandais (1994), des doutes et des zones d’ombres demeurent sur les raisons qui ont poussé la France à intervenir aux côtés du président Habyarimana. Ce midi stratégique tente de reconstruire le contexte politique et informatif du gouvernement français et d’analyser les raisons pour lesquelles la France n’a pas cessé de soutenir son allié, malgré le risque évident de génocide, identifié dès l’année 1990. Cette recherche met inévitablement en évidence un manque crucial d’analyses fines sur la politique africaine, loin d’être libérée d’une matrice de connaissance coloniale, héritée de l’impérialisme français
Enfants-soldats au Burkina Faso, un terreau favorable à une situation dramatique par Charlotte Dieu
Depuis la chute de la présidence de Blaise Compaoré en 2014, le Burkina Faso connaît une forte instabilité politique et sécuritaire qui a entrainé l’implantation pérenne de nouveaux groupes terroristes, notamment aux frontières nord du pays accolées au Mali et au Niger. En réponse à la gravité et au nombre croissant d’attaques perpétrées contre des écoles, le Secrétaire général des Nations unies (ONU) a fait part de son inquiétude quant à la situation des enfants, dont nombreux sont associés à ces formations terroristes. L’objectif de ce Midi stratégique est de revenir sur les facteurs qui favorisent aujourd’hui l’augmentation du recrutement et de l’utilisation d’enfants-soldats au Burkina Faso afin de sensibiliser et attirer l’attention du grand public sur ce phénomène croissant.
Inscription au Midi stratégique Afrique


Yannick Quéau était l’un des quatre invités de LN24 le 28 décembre pour l’émission « Rétro Inter 2021: retour sur les temps forts de l’actu inter(nationale) »

(Pour visionner l’émission sur LN24, cliquez ci-dessus et désactivez Adblock).